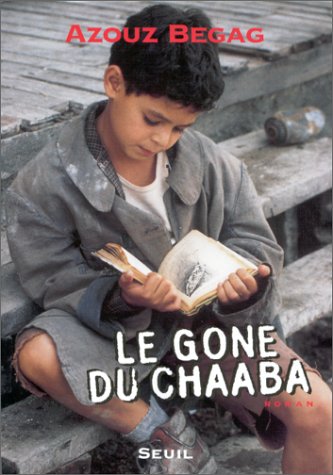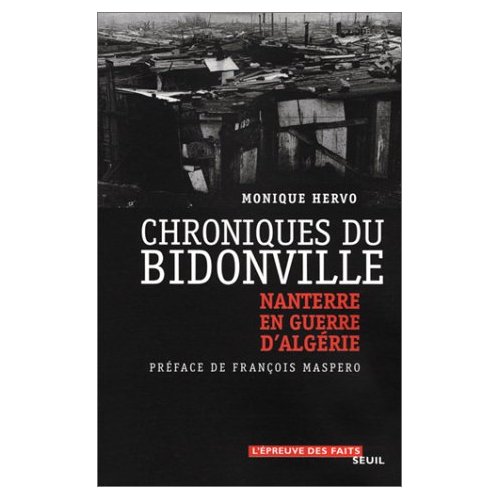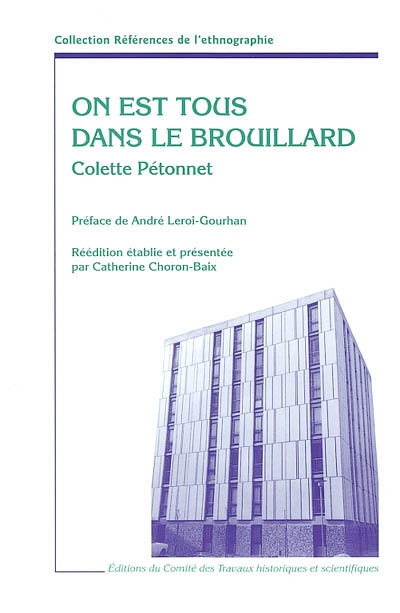Avec d’autres Français d’origine portugaise et des immigrés Portugais vivant en France, certains membres de l’association Mémoire Vive ont signé une tribune parue dans Le Monde pour protester contre l’instrumentalisation de l’histoire du bidonville de Champigny-sur-Marne.
Ces manipulations sont à la fois un manque de respect vis-à-vis de la vérité historique, de l’histoire des immigrés portugais en France et de ce qu’ils ont vécu et sont des armes xénophobes que nous ne pouvons pas accepter.
Si vous vous retrouvez dans cette tribune, que nous avons reproduit ci-dessous, n’hésitez pas à la diffuser ! Lien à partager
Une pétition a également été lancée https://www.change.org/p/hugo-dos-santos-non-%C3%A0-ceux-qui-voudraient-instrumentaliser-l-histoire-de-l-immigration-portugaise
La tribune a également été relayée au Portugal https://www.publico.pt/2018/01/10/sociedade/noticia/portugueses-contra-instrumentalizacao-da-historia-da-emigracao-para-franca-1798858
Ni bons ni mauvais: réponse à ceux qui voudraient instrumentaliser l’histoire de l’immigration portugaise
Il n’est pas rare de s’entendre dire que les immigrés portugais en France ne font pas d’histoires. D’une manière générale, cette immigration sert aujourd’hui d’exemple à ceux qui cherchent à mettre en avant une stratégie d’«intégration réussie», voire à mettre en avant une figure de «bon» immigré, un peu comme un professeur désignerait le chouchou de la classe.
Les incidents qui se sont déroulés à Champigny-sur-Marne le réveillon du Nouvel An ont été instrumentalisés en ce sens par le journaliste du Figaro Alexandre Devecchio, l’universitaire Laurent Bouvet et le journaliste Benoît Rayski. S’appuyant sur un article du Parisien, daté du 21 juin 2015, le premier déclare sur Twitter que «Champigny était le plus grand bidonville de France. Plus de 10.000 Portugais y vivaient dans la boue. Pas d’eau, pas d’électricité, etc. Et pas de violence, ni association pour crier au racisme. Qui peut dès lors nier la désintégration française?».
Cette allusion prétendument historique est reprise deux jours plus tard par Laurent Bouvet sur le plateau de «28 minutes» d’Arte, lors d’un débat portant sur la laïcité. Voulant démontrer que, de nos jours, le «problème des banlieues» ne serait plus seulement «social», il invoque les bidonvilles portugais où il «n’y avait pas de relations de violence». Enfin, sur le site Atlantico.fr, Benoît Rayski reprend ce même article du Parisien pour, également, opposer des populations immigrées et/ou issues de l’immigration. Selon lui, parmi les descendants de Portugais «aucun d’entre eux n’a appris à détester la France» mais «après eux d’autres populations sont venues».
Nous, immigrés et Français descendants d’immigrés portugais, nous ne pouvons tolérer ces affirmations et ceci pour deux raisons principales.
D’abord, s’il y a un bon élève, il y a forcément un mauvais élève. Et celui que l’on pointe du doigt est en l’occurrence, celui qui n’est pas «blanc» et/ou «chrétien». Nous comprenons évidement les allusions sans finesse de ces journalistes. En effet, nous avons pris l’habitude d’être instrumentalisés pour jeter la pierre sur d’autres populations jugées par certains comme inassimilables.
Dans les années 1980, le sociologue Albano Cordeiro (1) a mis en avant dans ses travaux la dynamique sociale qui consistait à invisibiliser l’immigration portugaise au profit d’une mise à l’index des immigrés maghrébins. Autrement dit, plus les «Arabes» devenaient indésirables, plus les Portugais devenaient invisibles et donc «intégrés». Ces immigrations sont donc liées depuis toujours, comme les deux faces d’une même monnaie, unies par le même mépris exprimé par une partie de la société d’accueil. Elles ont d’ailleurs été mise en concurrence depuis le départ. Rappelons que c’est pour freiner l’immigration algérienne que le gouvernement de Georges Pompidou ferme les yeux sur la venue clandestine de centaines de milliers de Portugais dans les années 1960-1970, fuyant la misère, la dictature et les guerres coloniales. A la figure de «l’Arabe» s’ajoutent aujourd’hui celle des Roms, des Africains subsahariens et des réfugiés fuyant les conflits du Proche-Orient.
D’autre part, les affirmations sur le bidonville portugais de Champigny-sur-Marne sont tout simplement fausses et non vérifiées. Il serait pourtant facile de se référer aux travaux de chercheurs l’ayant étudié. Si ces manipulateurs de l’Histoire pointent du doigt les misérables conditions de vie, ils oublient que lorsque ce bidonville a été médiatisé, en 1964, il avait fait l’objet d’une «humanisation» (2): raccordement à l’électricité, installation de points d’eau, collecte des ordures. Autant de rafistolages alors refusés aux bidonvilles où vivaient les Maghrébins. Un traitement différentiel, déjà.
Devecchio, Bouvet et Rayski nient toute «relations de violence» au sein du bidonville portugais. Relégués dans des espaces stigmatisés, de nombreux Portugais de l’époque ont souffert – et souffrent encore tant cette mémoire est difficile ou refoulée – d’une violence symbolique.
Violence exercée par les marchands de sommeil qui jouaient de la peur des travailleurs d’être dénoncés à la police politique portugaise dont ils suspectaient la présence d’informateurs en leur sein. Violence également de l’arbitraire qui présidait aux relogements par les autorités qui ne tenaient pas en compte la volonté des habitants de rester à proximité de leur emploi ou de leurs proches.
Face à ces relogements, certains ont résisté silencieusement, allant vivre dans un autre bidonville ou un autre taudis. D’autres protestaient, comme les habitants de Massy qui occupèrent temporairement la Mairie en 1970. Et, contrairement à l’image aseptisée que l’on colle aux Portugais, les autorités craignaient leurs réactions. Des forces de l’ordre étaient présentes à chaque opération de résorption, de peur de débordements.
Les travailleurs portugais ont eux aussi souffert du rejet de certains voisins qui se plaignaient de ces étrangers et exigeaient des autorités «l’intervention des forces de police (…): que le code civil soit respecté à Champigny». L’Histoire du bidonville de Champigny est donc bien plus complexe qu’on a voulu nous faire croire.
De plus, cette volonté de présenter les Portugais comme des gens sans histoires induit une injonction tacite: celle d’exister sans Histoire, voire sans mémoire. Nous ne pouvons l’accepter.
Quelle est notre Histoire? De quoi nous souvenons-nous? Des années de boue, évidemment, lorsque des dizaines de milliers de Portugais sont entassés dans des bidonvilles.
Sans papiers, ces immigrés ont cherché à survivre en travaillant où on leur en laissait la possibilité. Les métiers dont les Français ne voulaient plus leur étaient tout désignés: femmes de ménage, ouvriers du bâtiment, concierges, etc.
La clandestinité, l’exploitation, les bidonvilles, le racisme: nous avons vécu toutes ces expériences, comme les subissent les immigrants africains d’hier et d’aujourd’hui, à des degrés plus intenses. «La violence» dont parle Alexandre Devecchio c’est celle qu’on nous a fait subir hier et celle qu’on inflige aujourd’hui aux nouveaux arrivants qui fuient eux aussi la misère, des régimes oppresseurs et des guerres.
Enfin, rappelons que si certains d’entre nous ont choisi le silence, si rassurant dans une société qui tend à oublier la xénophobie exercée autrefois contre les Italiens, Espagnols ou Polonais, les immigrés portugais se sont aussi révoltés contre leurs conditions de vie en France, au grand dam des patrons français, des autorités et du régime de Salazar.
Nous pourrions ici évoquer la figure de Lorette Fonseca, une immigrée portugaise engagée dans l’alphabétisation du bidonville de Massy et qu’on a voulu expulser parce qu’elle aidait ses compatriotes à faire valoir leurs droits.
Nous pourrions également parler d’António da Silva. Cet ouvrier spécialisé de Renault Boulogne-Billancourt s’est battu contre les circulaires Marcellin-Fontanet en 1972-1973, le premier mouvement dit des «sans-papiers». L’arrêté du Conseil d’État qui annule plusieurs dispositions de ces circulaires porte son nom.
Qui se souvient de la participation active d’immigrés portugais à Convergence 84, une marche antiraciste qui s’est inscrite dans la continuité de la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, qualifiée par les médias français de «Marche des Beurs»? Son arrivée à Paris avait été accueillie par des dizaines de milliers de manifestants de tous les horizons.
Nous nous souvenons de tous ces épisodes de révolte et de combat comme de beaucoup d’autres. Certains ont un peu marqué les esprits, d’autres beaucoup moins. La plupart sont malheureusement inconnus de la société française qui a gommé l’Histoire de ses immigrés. Or, en oubliant l’Histoire de ceux qui ont reconstruit le pays et continuent de le construire, on travaille à sa «désintégration».
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons publiquement à l’instrumentalisation de notre Histoire et de notre mémoire qui font également partie de l’Histoire de France. Ces manipulations ne cherchent qu’à renforcer le racisme qui frappe aujourd’hui certaines populations stigmatisées, de la figure du «Musulman» à celle du «Rom». Le slogan de la marche de Convergence 84 était «La France, c’est comme une mobylette, pour qu’elle avance, il lui faut du mélange». Le slogan reste toujours d’actualité.
(1) Sociologue et économiste spécialiste des questions migratoires
(2) Terme alors employé par l’administration
Liste des signataires de la tribune :
Victor Pereira, maître de conférences
Hugo dos Santos, journaliste
Daniel Matias, journaliste
Artur Silva, journaliste
José Vieira, réalisateur
Albano Cordeiro, sociologue et économiste
Mickaël Cordeiro, chargé d’études
Irene Pereira, sociologue
Irène dos Santos, chargée de recherche CNRS/anthropologue
Marie-Christine Volovitch-Tavares, historienne
Manuel Tavares, pédopsychiatre
Graça dos Santos, professeure des universités
Manuel Antunes da Cunha, sociologue des médias
José Pinto, ancien administrateur CGT du FASIL-ACSE
Maria Maranhão-Guitton, avocat au barreau de Paris
António Topa, poète
Clara Domingues, traductrice
Mickaël Robert-Gonçalves, historien du cinéma
Octávio Espírito Santo, directeur de photographie
Rose-Marie Nunes, photographe
Christopher Pereira, professeur d’histoire-géographie
Josélia Martins, chef d’équipe en entreprise
Carlos Rafael, professeur de portugais, retraité
Elisabeth de Albuquerque, professeur des écoles et directrice d’école maternelle en ZEP
Maryse de Albuquerque, professeur de français, retraitée
Manuela de Albuquerque, enseignante, retraitée
Maria Alves, secrétaire-comptable
Manuel Pereira, enseignant retraité
Elsa Bernardo, professeur de lettres
Anne-Marie Esteves, consultante
Cândida Rodrigues, chargée de production
Carlos Ribeiro, journaliste
Jérémie de Albuquerque, chef de projet informatique
Pedro Fidalgo, gardien d’immeuble et cinéaste
Angela Pereira, femme de ménage, retraitée
Jorge Valadas, ancien déserteur de l’armée coloniale portugaise, électricien
Nuno Martins, électricien, responsable syndical à la CGT/RATP
João Fatela, directeur de service social, retraité
João da Fonseca, éducateur spécialisé, retraité
José Barros, directeur d’établissement médico-social, retraité
Isabel da Cunha, directrice hospitalité
Manuel Gregório, formateur d’adultes et conseiller en bilans de compétence
Vasco Martins, formateur, retraité
Ludivine Privat, travailleuse sociale
Faustine Leuiller, accompagnante d’élèves en situation de handicap
Isabelle Segrestin, orthophoniste
Luciana Gouveia, responsable associative
Luísa Semedo, enseignante universitaire et responsable associative
Ilda Nunes, professeur de portugais et responsable associative